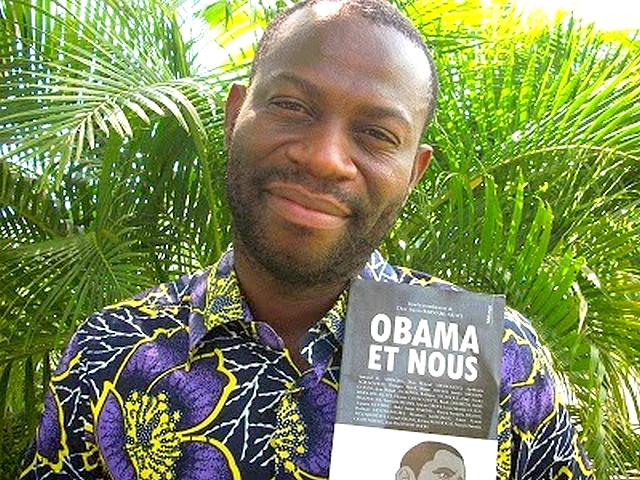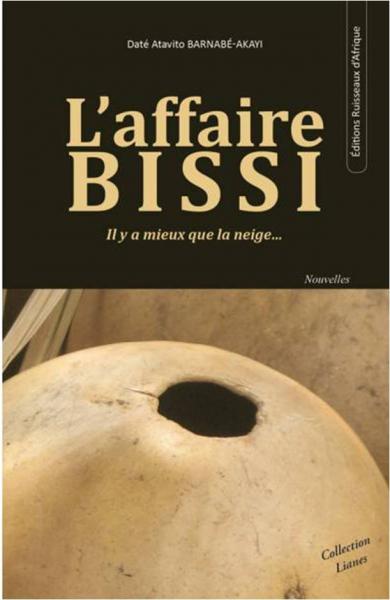#BringBackOurGirls : pourquoi je participe à la campagne contre Boko-Haram ?

Le 14 avril 2014, la secte islamiste Boko Haram a enlevé plus de 200 jeunes filles lycéennes nigérianes. Le rapt s’est produit dans la localité de Chibok dans le nord du Nigéria. Indignés par cet acte stupide, des habitants du pays, avec les mères des filles enlevées organisent une première manifestation pour réclamer le retour de « leurs » filles. Celle-ci a eu un tel écho planétaire que son mot d’ordre et hashtag « BringBackOurGirls » est devenu un cri de ralliement à travers le monde entier. La campagne a pris une telle ampleur que certaines personnes ont pensé qu’elle était devenue un effet de mode et a été récupérée par des personnalités célèbres pour se donner « bonne conscience à bas coût ». Un avis que je ne partage pas totalement même s’il est, en partie, vrai. C’est pourquoi, loin de toute cette polémique, j’ai décidé aussi de participer à la campagne. Pour des raisons précises bien sûr. En tout cas, deux mois après les premières manifestations, on ne pourra ni dire que je surfe sur la vague, encore moins que c’est pour me donner bonne conscience.
Démarche cathartique plutôt qu’un simple effet de mode
Il y a deux mois, dès les premiers jours de la campagne #BringBackOurGirls, je n’ai pas hésité à relayer quelques rares messages avec ce hashtag. J’étais à peine surpris quand j’ai reçu des réponses dans le style « Ceux qui enlèvent les filles ne sont pas sur Twitter », « Ce n’est pas ça qui va ramener les filles ». Et puis, il y a ceux qui ont accusé des stars d’avoir récupéré la campagne, et Dieu sait qu’il y a eu de la récupération dans cette affaire. Certes, je ne suis pas sans partager ces avis. Mais je trouve, toutefois qu’il y avait une volonté plus sérieuse. En effet, personnellement, j’étais un peu embarrassé devant l’image de certaines stars brancardant une affiche avec le hashtag #BringBackOurGirls visiblement sans savoir pourquoi elles le faisaient. Mais que dire de tous ces anonymes, indignés par cet enlèvement et qui ont décidé volontairement de s’exprimer publiquement à travers le monde. Moi je n’y trouve qu’une explication : la volonté des gens à faire partie d’une dynamique à travers l’impact des réseaux sociaux. Il y a dix ou vingt ans, un tel enlèvement aurait sans doute indigné autant de personnes à travers le monde, sans qu’elles ne puissent rien y faire. A part regarder la situation évoluer dans un sens ou dans l’autre. Aujourd’hui, à l’ère des réseaux sociaux, la situation est tout autre. A défaut de disposer de moyens militaires pour aller inquiéter les islamistes, on s’empare de Facebook, Twitter, YouTube pour faire entendre sa voix. Cela donne l’impression de faire partie de la solution ou au minimum de se situer du bon côté du problème. Rien que ça ! Rappelons-nous quand même qu’il a fallu une première manifestation de citoyens à Abuja avant que le gouvernement nigérian ne sorte finalement de son mutisme d’alors. Parce que je suis Béninois… S’il y a une raison supplémentaire pour laquelle je joins ma voix à cette campagne, c’est bien celle-là. Faut-il le rappeler, le Bénin partage une frontière de près de mille kilomètres du Sud au Nord avec le Nigéria. C’est dire que la menace de Boko Haram est tout aussi présente à notre porte et pourrait nous inquiéter à tout moment. Certes, pour le moment, ces islamistes alliés d’Al-Qaida concentrent leurs velléités d’extension vers le Nord-Ouest du Cameroun, mais le jour où ils se dirigeront vers les frontières Nord-Est de mon pays, les populations béninoises ne se sentiront pas plus en sécurité que les Nigérians en ce moment. Cependant, on est conscient que le hashtag #BringBackOurGirls ne va pas ramener les jeunes filles enlevées, pas plus qu’il ne ralentira les ouailles de Boko Haram dans leur sale entreprise. Mais si ça peut aider à opérer un progrès, fut-il mince, pourquoi ne pas l’exploiter.